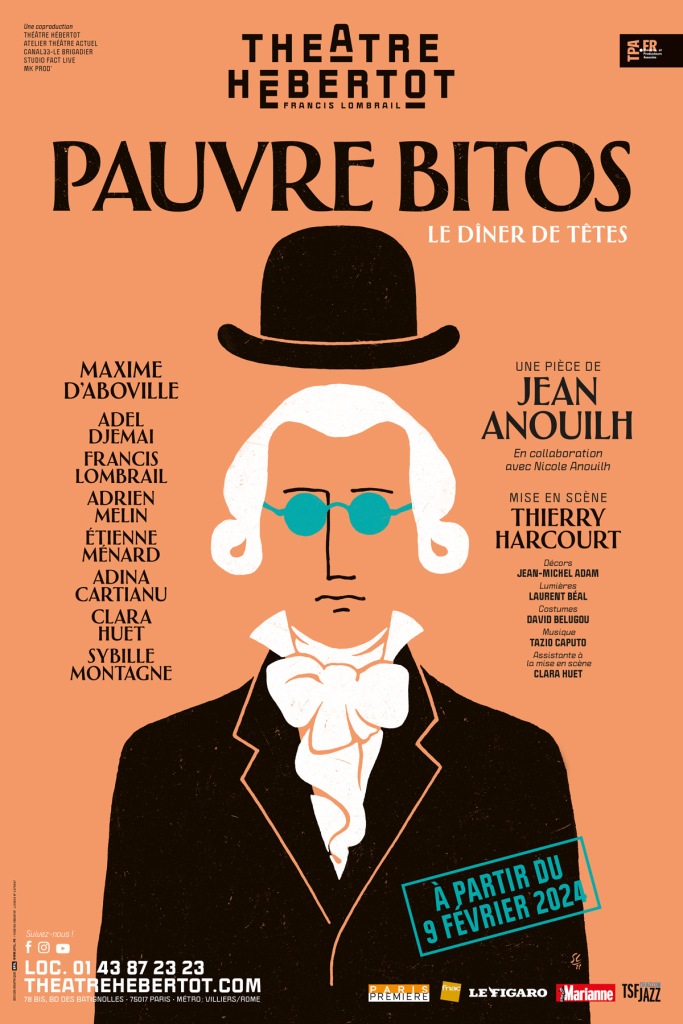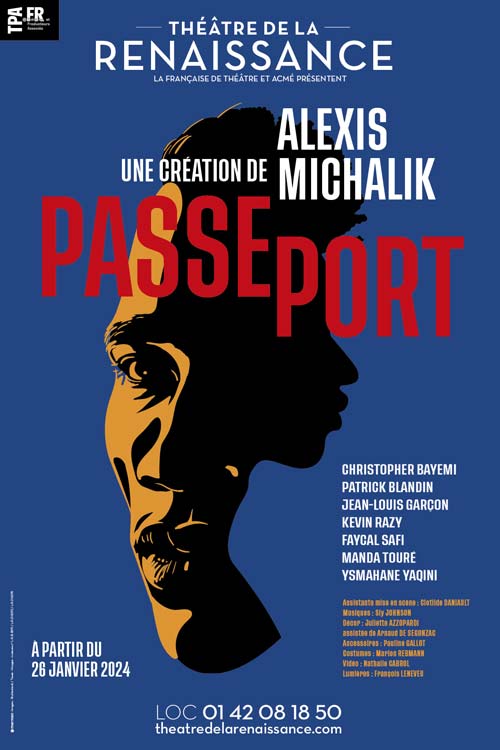Critique de Duplex, de Didier Caron, vu le 6 mars 2024 au Théâtre de Paris
Avec Corinne Touzet, Pascal Legitimus, Francis Perrin et Anny Duperey, mis en scène par Didier Caron
J’ai l’impression d’avoir écrit le même article il n’y a pas longtemps. Cet article où je commence en disant que j’avais des gros doutes sur le spectacle que j’avais choisi – c’était pour La Joconde parle enfin. Pour Le Duplex, ce ne sont pas des doutes que j’avais. C’était une certitude absolue. Ce spectacle ne m’était pas destinée. Mais pourquoi y aller quand même me direz-vous ? Mais parce que je suis un mouton, parce que je sais que ce sont de bons comédien et je ne peux pas m’empêche de me dire : « et si… ? ». Après tout, sur un malentendu, ça peut marcher.
Le duplex réunit deux couples de voisins, ceux du 6e, incarnés par Pascale Légitimus et Corinne Touzet, et ceux du 5e, ce sont Francis Perrin et Anny Duperey. Les voisins du 6e aimeraient bien agrandir leur appartement pour en faire un duplex, et pour cela racheter l’appartement du dessous. Seulement voilà : il est plus que probable que les voisins n’aient aucunement l’intention de vendre. La seule solution qui leur reste, c’est de les pousser au divorce.
J’adore ce genre de soirée. Et pourtant je pense que ça se joue à rien. Peut-être que dans un autre état d’esprit, je me serais complètement fermée à ce spectacle. Parce que le texte est à peu près comme je m’attendais : pas fou. Il y a pire, il y a les textes qui n’ont même pas d’essence dramaturgique, ce qui n’est pas le cas de celui-ci. Mais on ne vole pas très haut non plus. C’est le genre de texte devant lequel, à la manière d’une IA qui a déjà avalé un bon nombre de textes dans le genre, j’ai deviné en cinq minutes le dénouement du spectacle et je vois toutes les vannes arriver à des kilomètres. C’est le genre de texte qui peut me donner envie de partir – ou de dormir.
Et pourtant, loin de me braquer, je commence à sourire. Je ne peux pas dire que je m’ennuie. Je crois d’abord à l’effet « tant qu’on est là ». Je me retrouve à rire autant de la vanne que de sa bêtise ou de son culot. Mais pour ça, il a bien fallu que, quelque part, je me fasse attraper par la pièce. Que j’oublie de la repousser. Et je comprends vite la magie de ce qui est en train de se jouer. Je m’aperçois en fait que je suis beaucoup trop investie dans ce spectacle par rapport à ce que mon cerveau essaie de me faire croire. Ce n’est pas seulement de la curiosité.
D’abord, il faut dire mon bonheur de retrouver sur scène Anny Duperey. Lorsqu’elle est sur le plateau, je n’ai d’yeux que pour elle. Quelle légèreté. Quelle spontanéité. Quelle fraîcheur. Quelle irrévérence. Quelle lumière. Quelle classe. Quelle liberté. Quelle énergie. Quel souffle. Chacune de ses répliques est un délice. Chacun de ses mots se savoure. Sa diction a quelque chose de l’ordre du phrasé musical. Elle irradie. Elle semble flotter au-dessus du plateau. Elle est merveilleuse.
Mais Anny Duperey aussi incroyable soit-elle ne peut me faire passer du rien au tout. Il faut bien le reconnaître : je ne décroche pas. Et je dirais même plus : j’accroche. Ce qui se joue sous mes yeux a quelque chose de fascinant. En fait, je crois que je n’ai jamais vu des acteurs aussi bons sur un texte pareil. Ils le subliment. Il n’y a pas d’autre mot. C’est du grand art. Et, disons le carrément, ce n’est pas seulement du grand art d’arriver à faire autant avec aussi peu. Ils ne sont pas seulemnet excellent par rapport à leur matériau de base. Ils sont excellents tout courts. Je crois que ça faisait longtemps que je n’avais pas été face à un quatuor d’acteurs aussi bon. Ni passé une aussi bonne soirée. Voilà, c’est dit.
Moi qui croyais que j’avais besoin d’un texte avant tout, voilà l’exception qui confirme la règle. ♥ ♥ ♥
Le Duplex – Théâtre de Paris
15 rue Blanche, 75009 Paris
A partir de 20 €
Réservez sur BAM Ticket !